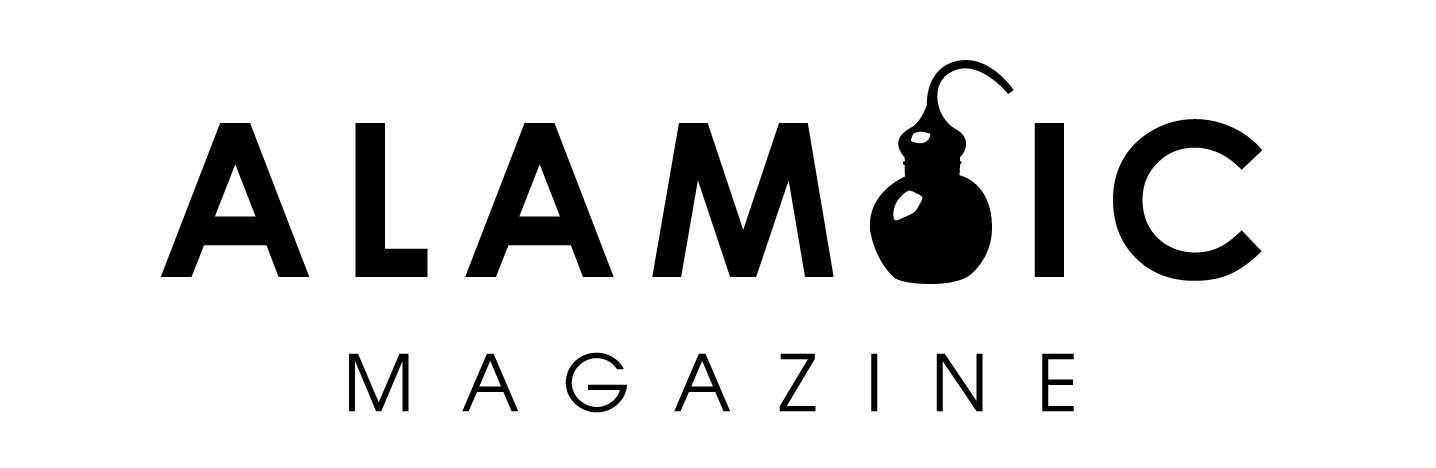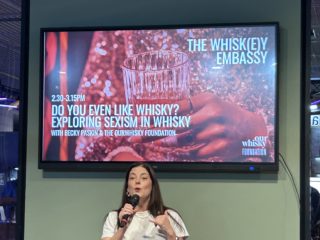Si l’on cherche une constante dans les relations entre le pouvoir et l’alcool, elle est très simple à trouver : le bourgeois est capable de contrôler sa consommation ; il n’y a danger que lorsque l’autre se met à boire. En France, on avait fini par couper les ailes de la fée verte, pour mentionner un cas emblématique, lorsque le prolétaire, non content de s’y mettre, avait en plus eu la mauvaise idée de se faire tuer moins efficacement sur le front en 14. Véridique.
De même, le cocktail était un passe-temps insignifiant, réservé à « la clientèle étrangère, (…) certains milieux du monde des courses, de la littérature, du théâtre », selon un médecin scandalisé, jusqu’à — enfer et damnation! — la naissance de « l’alcoolisme mondain » because la femme. C’est que la bourgeoise, cette figure qui valait à peine mieux que le prolo, y avait pris goût. Et un collègue dudit médecin de s’indigner : les Américaines avaient introduit le cocktail en France et contaminé par « snobisme » les « femmes et les jeunes filles françaises ». Nous sommes en 1929, et depuis 10 ans, ô misère, la femme s’est en effet découvert des goûts masculins…
Passion pour le charleston, coupes à la garçonne, jupes courtes, bolides, aventures sentimentales qui vont un peu trop loin, cigarettes égyptiennes et, donc, le cocktail : voici la femme moderne, aisée bien sûr, américanisée aussi et, en bonne logique, transformée en danger social. Son privilège ainsi menacé, même l’homme soi-disant ouvert à l’altérité ne peut s’empêcher de se rebiffer : « Les femmes vinrent au cocktail », écrit Lucien Farnoux-Reynaud dans L’heure du cocktail. « Il fallu bientôt les accepter dans nos retraites des capitales, et nos catacombes se transformèrent en chapelles élégantes. L’époque héroïque du cocktail était close ». Car oui, voyez-vous, l’héroïsme a la moustache fournie et les testicules lourds.

Entre, d’un côté, les doctes médecins ou les défenseurs de la gastronomie avec un grand G (la mode du cocktail est « une nouvelle preuve de notre veulerie éberluée devant l’envahissement des métèques et d’une grave perturbation du goût français » nous dit, toujours en 1929, un écrivain qui finira pétainiste), et, de l’autre, les Pygmalion modernes à la Farnoux-Reynaud (son texte vise à « instruire en cet art délicat et primordial » une jeune femme qui boit ce qu’elle aime — et ignore par la même ce que le bon Lucien juge qu’elle devrait aimer), la femme n’a donc que deux options : cesser de boire ou boire ce que le moustachu de service lui dit de boire.
Heureusement, les jeunes femmes françaises ne sentirent pas l’obligation de suivre les ordres de la faculté. Et si elles adoptèrent parfois les recommandations de jeunes coqs plus expérimentés qu’elles, ce fut, on l’espère, seulement lorsque leur palais leur démontrait que c’était mieux ainsi. Heureusement, dis-je, car si la France a véritablement connu un âge d’or du cocktail dans les années 1920 et 1930, c’est précisément car « les jambes affranchies » et les nuques rasées à en « défier une guillotine » (Farnoux-Reynaud dixit) ont alors rempli les bars et se sont mises à agiter le shaker lors des cocktail parties qu’elles organisaient, à l’instar des stars du ciné muet. Et si le cocktail français connait un second âge d’or aujourd’hui, c’est probablement pour la même raison. Le bon sens du négoce des bars veut qu’un établissement aura du succès s’il attire un peu plus de femmes que d’hommes. Voilà qui tombe bien : il y a en France un peu plus de femmes que d’hommes. Sans elles, votre bar à cocktail n’existerait probablement pas. C’est une question d’équilibre, j’imagine.